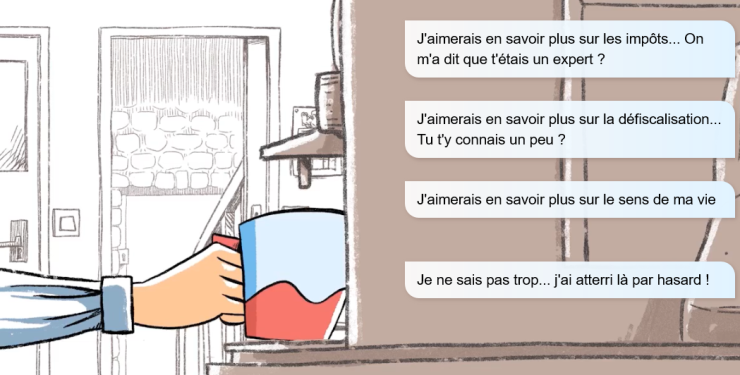THEME 6 - Comment l’Etat peut-il intervenir dans une économie ?
Cette page contient un ensemble de recommandations pédagogiques pour traiter le thème 6 du programme de terminale STMG de la spécialité économie ainsi que des liens vers des ressources pédagogiques.
(N.B : Les thèmes numérotés de 1 à 5 ont été traités dans le programme de l’enseignement de spécialité de droit et économie de la classe de première.)
Objectifs pédagogiques : De nombreux débats concernent le degré et les modalités de l’intervention de l’État dans l’économie. Ils opposent notamment les tenants d’une intervention minimale aux tenants d’une intervention systématique destinée à corriger les insuffisances éventuelles du marché.
Face aux défaillances du marché, l’État peut améliorer l’information économique des différents agents, lutter contre les monopoles ou les ententes illégales entre entreprises, intervenir sur les externalités ou prendre en charge la production de biens publics. Il peut être conduit à se désengager de secteurs qu’il ne peut plus gérer tout seul (énergie, télécommunications, autoroutes, etc.). Il peut également engager des politiques d’offre (baisse du coût du travail, amélioration du niveau d’éducation, etc.) ou de demande (hausse ou baisse des taxes fiscales, impôts, aides sociales), de façon conjoncturelle ou structurelle, afin de favoriser la croissance à court ou à long terme. Enfin, pour corriger les inégalités sociales, l’État peut s’appuyer sur deux volets : au niveau de ses recettes, sur une fiscalité plus ou moins progressive ; au niveau de ses dépenses, sur une politique sociale plus ou moins redistributive.
Après avoir étudié ce thème, l’élève sera capable :
- d’expliquer les différences entre les notions d’État-gendarme et d’État-providence, et d’envisager le degré de participation de l’État à l’économie via des entreprises publiques, semi-publiques ou privées ;
- de distinguer le déficit public de la dette publique ;
- de justifier pourquoi l’allocation des ressources n’est plus efficace en présence d’une défaillance de marché ;
- d’énoncer des solutions permettant de corriger ces défaillances de marché ;
- de citer des situations où l’on peut parler de défaillance de l’État ;
- de désigner les principaux outils et canaux de transmission des politiques budgétaire et monétaire ;
- d’énumérer et de distinguer les fonctions respectives des politiques d’offre et de demande qui peuvent s’inscrire alternativement ou concomitamment dans des cycles conjoncturels ou structurels ;
- de décrire l’évolution du rôle de l’État dans le cadre européen ;
- d’énumérer les différents modes de financement des dépenses publiques ;
- de caractériser la progressivité des différents prélèvements obligatoires ;
- de désigner les objectifs des politiques sociales et de protection sociale ;
- d’énumérer et d’expliquer les principaux risques sociaux couverts par la protection sociale ;
- de distinguer la redistribution horizontale et la redistribution verticale des ressources.
PROGRAMME ET RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES
THEME 6 - Comment l’Etat peut-il intervenir dans une économie ?
| Une notice d’accompagnement pour les professeurs sur les notions étudiées dans le thème 6 |
Pour chaque sous-thème vous trouverez ci-dessous :
- Le programme avec le contexte et les finalités de chacun d’entre eux.
- Les indications complémentaires : conseils didactiques et pédagogiques.
- Des ressources pédagogiques.
Recommandations pédagogiques pour le sous-thème 6.1. L’intervention de l’Etat
6.1. L’intervention de l’Etat
Indications complémentaires - conseils didactiques et pédagogiques :
L’élève doit comprendre que l’intervention de l’État est nécessaire au bon fonctionnement de l’économie. Depuis plus d’un siècle, l’État que l’on qualifiait de gendarme est désormais un État providence. Aux fonctions régaliennes (police, justice, armée) se sont progressivement ajoutées des fonctions de régulation (cadre juridique permettant le bon fonctionnement des relations économiques), de protection sociale (création de la Sécurité Sociale), de production (l’État produit à travers des entreprises publiques, semi-publiques et prend des parts dans des entreprises privées).
L’ensemble de ces domaines d’intervention demande aux administrations publiques de mettre en œuvre des dépenses publiques. Ces dépenses peuvent être décidées par l’administration centrale (via ses ministères), les administrations de sécurités sociales ou les collectivités locales. Pour pouvoir dépenser, l’État doit se constituer des ressources financières (recettes). Pour cela il doit collecter des prélèvements obligatoires. Plus ces impôts et taxes prélevés représentent une part importante du PIB, plus l’État aura de domaine d’intervention et on le qualifiera alors d’interventionniste. Si à l’inverse le niveau de prélèvement est faible et qu’il intervient peu on parlera d’État plutôt libéral.
En étudiant les recettes et les dépenses de l’État français, on pourra montrer à l’élève que les dépenses publiques sont depuis plusieurs décennies supérieures aux recettes de l’État et que la somme des déficits publics accumulés aboutit aujourd’hui à une dette publique équivalente au PIB.
Enfin pour intervenir, l’État est également un employeur. L’État emploie soit directement des fonctionnaires, soit indirectement à travers certains de ses monopoles publics. Il sera pertinent d’en profiter pour montrer à l’élève la part de l’emploi public en France, ainsi que lui dresser un historique des privatisations et de l’ouverture à la concurrence, notamment dans l’histoire récente.
Finalement, pour l’élève, ce chapitre doit constituer une introduction au reste du thème. Il convient qu’il ait compris l’importance majeure de l’État dans l’économie française afin de pouvoir dans les chapitres suivant approfondir les fonctions d’allocation des ressources, de stabilisation de la conjoncture économique et enfin de redistribution des revenus.
| Les fonctions de l’État ont progressivement évolué d’un État exerçant une intervention minimale (ordre public, protection du pays, prélèvement des impôts) à un État-Providence combinant des fonctions de régulation et de stabilisation, d’allocation des ressources et de redistribution, ces fonctions étant le plus souvent concomitantes. La place de l’État peut être appréciée notamment à travers l’importance relative des prélèvements obligatoires dans l’économie (prélèvements obligatoires/PIB), à travers l’identification des domaines et des modalités d’intervention de l’État (par exemple, la protection sociale), et à travers le volume de ses dépenses. Le degré d’intervention de l’État dépend des choix de société réalisés (interventionnisme ou libéralisme). L’essentiel des ressources des administrations publiques provient des prélèvements obligatoires. Il y a déficit public lorsque les prélèvements obligatoires sont insuffisants pour couvrir les dépenses publiques. Ce déficit nourrit la dette publique. L’État est également un employeur et gère des monopoles publics (SNCF et RATP par exemple). Il est soumis à des choix de règlementation ou de dérégulation. Certains monopoles publics ont connu une ouverture à la concurrence : c’est notamment le cas des télécommunications après la vente des réseaux hertziens. |
L’État gendarme et l’État-providence. L’État et les entreprises publiques, semipubliques et privées. L’interventionnisme et le libéralisme. Les dépenses publiques. Le déficit public et la dette publique |
Ressources sur l’intervention de l’Etat
| Service public, entreprises publiques | Une séquence du CRCOM (à actualiser) qui permet d’aborder la problématique suivante : Quelle est l’évolution actuelle du rôle de l’État sur le marché des biens et services ? Services publics, entreprises publiques ; Monopoles naturels, ouverture des marchés à la concurrence ; Politique de la concurrence, autorités administratives indépendantes. |
| L’interventionnisme | [Une activité interactive sur l’intervention de l’Etat->https://pedagogie.ac-montpellier.fr/activite-interactive-millionnaire-sur-les-interventions-de-letat] proposée par l’académie de Montpellier. ll s’agit d’une activité ludique qui permet de vérifier les connaissances liées aux interventions de l’État. Pour accéder à l’activité interactive, attendre l’affichage de l’animation puis suivre les consignes. Une vidéo Dessine moi l’économie « Comment la presse papier va-t-elle disparaître ? Comment les acteurs de la presse papier parviennent-ils à survivre malgré la crise majeure que vit la filière depuis l’avènement du numérique ? Comprendre comment l’État maintient l’ensemble de la presse papier à flot grâce aux nombreuses aides qu’il accorde.
|
| Les dépenses publiques | Une vidéo Dr CAC – Le budget de la France
|
| Déficit public - Dette publique | Une vidéo Dr CAC – Pourquoi la dette augmente ?
|
Recommandations pédagogiques pour le sous-thème 6.2. Défaillances des marchés et défaillances de l’Etat :
6.2. Défaillances des marchés et défaillances de l’Etat
Indications complémentaires - conseils didactiques et pédagogiques :
L’objectif de ce sous-thème est que l’élève comprenne que certaines défaillances du fonctionnement « naturel » des marchés entrainent une mauvaise allocation des ressources et que comme nous l’avons dit point 6.1, c’est pour cela que l’État doit intervenir.
Tout d’abord, l’État doit intervenir pour limiter les asymétries d’information. C’est-à-dire le fait que sur un marché, une des deux parties de l’échange ne dispose pas des mêmes informations que l’autre. Le problème est que l’information imparfaite peut pousser l’une des parties à faire un choix qu’elle n’aurait pas fait si elle avait eu toutes les informations. Il s’agit d’une mauvaise allocation des ressources. Pour que l’élève comprenne cela il est préférable de prendre des exemples et des problématiques très concrets : les consommateurs de lasagnes en aurait-il acheté s’ils avaient su qu’il y avait de la viande de cheval dedans ? Achèterait-on si souvent des nouveaux smartphones si nous savions que des enfants en extraient la matière première dans des mines de pays en développement ? Ainsi, pour que les marchés fonctionnent parfaitement, il faut que la transparence de l’information soit assurée pour que le consentement à l’acte d’achat ne soit pas vicié. L’existence de label ou d’autorités administratives indépendantes pour assurer la bonne information pourront être étudiées.
Comme nous l’aurons montré aux élèves en classe de première (point 5.1), il existe des situations de marché oligopolistique ou monopolistique qui conduisent à avoir un prix supérieur au prix de marché en situation de forte intensité concurrentielle. Ce prix « trop élevé » entraine un nombre de ventes inférieur à ce qu’il devrait être et un « surprofit » pour les entreprises qui profitent de la concurrence imparfaite. Nous aboutissons ainsi à une mauvaise allocation des ressources. Pour lutter contre cela, l’État s’appuie sur sa politique structurelle de la concurrence. Le professeur pourra choisir opportunément de traiter de la politique de la concurrence (point 6.3) à ce moment de sa progression pédagogique.
Les externalités représentent des situations dans lesquelles l’action d’un agent affecte le bien-être d’un autre agent sans que cela amène à une compensation monétaire entre les deux agents. Il existe de ce fait des externalités positives – la vaccination qui nous protège mais protège aussi les autres – et des externalités négatives – la pollution de notre voiture qui dégrade le bien-être des autres.
Les externalités mettent donc en avant une défaillance du marché. L’élève comprendra donc que le marché ne conduit pas à la meilleure allocation. L’intervention de l’État est donc indispensable pour guider les comportements individuels et inciter les agents à prendre des décisions socialement optimales. À ce titre, il sera possible d’étudier avec l’élève le système de bonus/malus qui peut se justifier par le fait de pénaliser les plus gros pollueurs et de récompenser les pollueurs les plus légers.
Les biens publics sont des biens pour lesquels la production par l’État est plus efficace que la production par le marché. En effet, les biens publics sont des biens dont la consommation associe deux caractéristiques qui rendent les entreprises privées inaptes à leur production : la non rivalité et la non exclusivité. La non rivalité signifie que plusieurs personnes peuvent consommer le bien en même temps sans diminuer la satisfaction des autres, et la non exclusivité signifie qu’il est très difficile d’exclure un agent de la consommation dudit bien. On pourra illustrer cela pour l’élève en utilisant un exemple très simple comme l’éclairage public par exemple. Tout le monde profite également de l’éclairage public et il est difficile de tarifer la consommation d’éclairage public. En effet, il suffit qu’une personne paye pour que tout le monde en profite, et par conséquent personne n’acceptera de payer pour ce type de bien : le comportement rationnel individuel consiste en effet à attendre qu’un autre agent finance ce bien pour en profiter gratuitement par la suite. C’est pour cela que l’État est le seul agent à pouvoir financer ce type de biens qui contribue à améliorer le bien-être collectif.
Il conviendra également de mentionner les biens communs. Par exemple, les espaces naturels comme les forêts, les lacs, les océans sont autant de biens naturels non exclusifs mais qui deviennent progressivement rivaux. En effet, la surutilisation des biens communs ne permet plus à tout le monde de les utiliser librement. C’est à l’État de garantir l’utilisation optimale des biens communs pour éviter cela.
Enfin, on pourra montrer par des exemples que parfois, l’intervention de l’État est défaillante :
- des décisions prises par l’Etat favorisent parfois de manière disproportionnée certains acteurs économiques au détriment de l’ensemble des citoyens ;
- l’État peut s’avérer défaillant dans la gestion de nombreux services publics : l’état des hôpitaux ou le traitement de sa main d’œuvre est un exemple que l’actualité récente a révélé ;
- l’inaction de l’État en matière de gestion des biens communs naturels peut également être étudiée.
Les interventions économiques de l’État visent à corriger les défaillances et dysfonctionnements des marchés. Usuellement, on dénombre quatre types de défaillances des marchés :
|
Les défaillances des marchés.
|
Ressources sur les défaillances des marchés et les défaillances de l’Etat
| Les défaillances des marchés | Une séquence sur Eduscol qui aborde les défaillances des marchés : |
| Monopole, oligopole | Pour illustrer les défaillances des marchés une vidéo Dessine moi l’économie « Monopole, oligopole » L’Etat doit-il interdire les monopoles et les oligopoles ? « Monopole », « oligopole »… ces termes peuvent faire un peu peur ! Que fait l’État face à ces situations de concurrence imparfaite sur certains marchés ?
|
| Les défaillances de l’Etat | Une vidéo Dr CAC – Un Etat peut-il faire faillite ?
|
Recommandations pédagogiques pour le sous-thème 6.3. Les politiques économiques de l’Etat et de l’Europe :
6.3. Les politiques économiques de l’Etat et de l’Europe
Indications complémentaires - conseils didactiques et pédagogiques :
Dans ce point on aborde avec l’élève la seconde fonction de l’État, celle de la stabilisation de l’économie. Cette fonction renvoie à plusieurs objectifs qui sont à la fois la création d’emploi, la stabilité des prix et l’équilibre du commerce extérieur ainsi qu’une croissance économique solide sur laquelle nous nous focaliserons principalement dans ce chapitre.
Pour que l’élève comprenne la politique de stabilisation, il conviendra que l’élève comprenne d’abord que l’économie est par essence instable. La description de l’économie en termes de cycles est souvent utilisée en économie afin de décrire l’instabilité et de tenter de l’expliquer. Un cycle économique court est un enchaînement de phases d’expansion, de crise, de récession et de reprise lié à la conjoncture économique. Un cycle long est davantage lié à des variables démographiques et technologiques.
Pour agir sur ces différents cycles l’État peut mettre en œuvre des politiques conjoncturelles qui cherchent à « contrer » le cycle et auront une action de court terme, mais aussi des politiques structurelles qui auront plutôt une action de long terme. Le professeur pourra décrire quelques politiques structurelles dont le développement n’est pas forcément propre à ce thème :
- Les politiques structurelles réglementaires qui permettent d’offrir un cadre juridique propice au développement économique (droit de propriété, liberté d’entreprendre, concurrence loyale, droit du travail, droit des contrats…)
- Les politiques structurelles de production de biens et services publics consistent pour l’État à produire les biens et services publics. Par exemple, l’État finance et produit les biens et services publics comme l’éducation, la recherche, les services de santé et les infrastructures de transport et d’énergie, l’armée, la police, la justice...
- Les politiques structurelles sociales qui visent à limiter les risques économiques et sociaux.
- Les politiques structurelles de la concurrence qui sont des politiques réglementaires encadrant les structures de marché monopolistiques et oligopolistiques quant à leurs positions dominantes et des pratiques d’ententes (lien à faire avec le point 6.2 sur la régulation dans le cas de défaillances de marché).
Il convient ensuite d’expliquer à l’élève le fonctionnement des instruments de politiques budgétaire et monétaire ainsi que l’importance qu’elles ont en matière de stabilisation de la conjoncture économique.
L’instrument de la politique budgétaire de l’État est comme son nom l’indique, le budget (recettes et dépenses de l’administration centrale). Cet instrument peut être utilisé dans deux sens en fonction des objectifs :
- Si l’État souhaite relancer la croissance, il peut choisir de mettre plus d’argent dans le circuit économique en augmentant son déficit (baisse des impôts et/ou augmentation des dépenses).
- Si l’État souhaite diminuer sa dette ou son déficit (pour respecter les critères européens de déficit et de dette), il peut mettre moins d’argent dans le circuit économique en réduisant son déficit (baisse des dépenses et/ou augmentation des impôts).
L’instrument de la politique monétaire est le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale. Dans la Zone Euro, c’est la Banque Centrale Européenne (BCE, voir point 4.2) qui a le contrôle du taux d’intérêt directeur. Cet instrument peut être utilisé dans deux sens en fonction des objectifs :
- la BCE peut baisser le taux d’intérêt directeur pour relancer la croissance ;
- la BCE peut augmenter le taux d’intérêt directeur pour limiter la surchauffe économique.
Il faudra montrer à l’élève que ces différentes politiques sont complémentaires et dépendantes les unes des autres pour permettre à l’État de réaliser pleinement son rôle de stabilisateur.
| Afin de stabiliser les grands agrégats macroéconomiques (produit intérieur brut, emploi, stabilité des prix, commerce extérieur), l’État peut mettre en œuvre des politiques d’offre ou de demande fondées, par exemple, sur l’abaissement des coûts des facteurs de production, l’aide à l’innovation, les incitations financières, l’abaissement ou la hausse des impôts directs, indirects et des aides sociales. Les politiques à plus long terme visent, quant à elles, à modifier durablement le fonctionnement du système économique. Elles doivent créer un cadre favorable à la croissance et au développement d’un territoire. Parmi ces politiques, on trouve notamment les politiques de remise à la concurrence d’anciens monopoles d’État, la politique de la concurrence et de lutte contre les cartels, l’économie de la connaissance, la politique de recherche et d’innovation. En Europe, le processus d’intégration économique et monétaire a entraîné la mise en place d’une politique monétaire pour les pays membres de la zone euro ainsi que des règles communes de politique budgétaire. Cette intégration a été adoptée pour garantir le développement économique de l’Europe par une meilleure coordination des politiques budgétaires, la convergence des taux d’intérêts, le développement des échanges et le soutien aux politiques sectorielles et d’aménagement du territoire. |
Les fluctuations et les cycles économiques (expansion, récession, dépression, crise) La politique contracyclique La politique budgétaire La politique monétaire. Les politiques de la concurrence. La politique monétaire européenne. Les politiques budgétaires de relance ou de stabilisation et les critères européens des déficits publics |
Ressources sur les politiques économiques de l’Etat et de l’Europe
| Politiques économiques | Une séquence du CRCOM (à actualiser) qui pose la problématique "La crise financière de 2008 a-t-elle modifié les contraintes pesant sur les politiques économiques dans la zone euro ?" et qui permet d’aborder les notions suivantes : La coordination des politiques économiques, le financement du déficit budgétaire, la dette souveraine. Le CRCOM met à disposition le dossier professeur dans l’espace corrigé. |
| Fluctuations et cycles économiques | Une vidéo Dessine moi l’économie « COVID 19 : quel avenir pour l’économie ? » La crise économique liée à la Covid-19 a déjà frappé de plein fouet la quasi-totalité des États. La France n’y échappe pas avec une chute historique de son PIB de 13,8 % au deuxième trimestre 2020. Quels sont les impacts à court terme de cette crise et comment va-t-elle évoluer à long terme ? Explications, en dessins.
|
| La politique contracyclique | Une vidéo Dessine moi l’économie « Austérité ou relance ? comment ça marche ? »
|
| Politique budgétaire et monétaire | Une vidéo Cité de l’économie « Qu’est-ce que la politique budgétaire ?
|
| Les politiques de la concurrence | Un dossier sur le site de la commission européenne sur la politique de la concurrence
|
| La politique monétaire européenne | Une présentation de la politique monétaire européenne sur le site de la Banque de France Une vidéo Dessine moi l’économie “ Peut-on concilier diversité des modèles européens et monnaie unique ?" Dans le cadre de la monnaie unique, quels sont les modèles en Europe qui sont les plus efficaces ? Une harmonisation est-elle indispensable ?
|
| Le budget de l’Europe | Une vidéo Dessine moi l’économie sur « Le budget de l’Union Européenne »
|
| Les critères européens des déficits publics | Une vidéo Dr CAC – Qu’est-ce que le fond européen de stabilité financière (FESF) ? |
| Le BREXIT | Une vidéo Dessine moi l’économie « Le BREXIT, c’est quoi la suite ? » Alors le Brexit ? Grand chambardement ou pétard mouillé ? Ce vote des Britanniques en faveur de la sortie de l’Union Européenne a fait les gros titres, d’autant plus que personne ne s’attendait à ce résultat. Quelles sont les raisons qui expliquent ce départ et quelles conséquences celui-ci peut-il avoir ?
|
Recommandations pédagogiques pour le sous-thème 6.4. Les politiques sociales :
6.4. Les politiques sociales
Indications complémentaires - conseils didactiques et pédagogiques :
L’élève devra comprendre que l’individu est amené au cours de sa vie à subir différents évènements que l’on qualifiera ici de risques sociaux. Il existe différents risques sociaux tels, la vieillesse, la maladie, la maternité, les accidents du travail, le chômage.
Pour chacun de ces risques les conséquences sont l’impossibilité (ou la grande difficulté) de travailler et d’en tirer un revenu, ou l’augmentation des dépenses.
En plus des risques sociaux, les ménages peuvent être confrontés à des risques économiques. Ainsi il convient également de présenter à l’élève les différentes inégalités socio-économiques ainsi que le niveau de pauvreté auquel les ménages français sont confrontés (lien à faire avec le point 2.3 et l’analyse du partage de la valeur ajoutée).
Quand l’élève aura constaté les différents risques économiques et sociaux, il conviendra de lui montrer les moyens que peut mettre en place l’État pour les limiter.
La politique de protection sociale suit deux principes distincts :
- La logique d’assurance qui consiste au versement d’allocations compensatoires d’un risque avéré à des individus qui ont contribué via des cotisations sociales (redistribution horizontale des bien-portants vers les malades, de ceux qui ont un emploi vers les chômeurs…). Exemples : protection des risques de chômage, de maladie, liés à la vieillesse…
- La logique d’assistance qui consiste en des prestations monétaires ou en nature (des services) financées par les impôts (redistribution verticale des plus riches vers les plus pauvres). Exemples : protection des risques de pauvreté, d’exclusion, de difficulté de logement, d’accès à la santé… (prestations telles que la CMU ou le logement social).
La solidarité est un principe fondateur présent dans la logique d’assistance comme dans la logique d’assurance des systèmes publics de protection sociale (à distinguer des assurances privées).
Le financement de la protection sociale par les prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales) est en partie progressif. Pour démontrer cela, le professeur peut s’appuyer sur ce qui a été étudié au point 2.3, particulièrement en ce qui concerne l’impôt sur le revenu. La problématique de la redistribution par la progressivité de l’impôt est à traiter. On pourra questionner l’efficacité de la politique sociale sur ce point.
| L’un des instruments clefs de l’exercice de la fonction redistributive de l’État est la politique sociale. Celle-ci protège les individus contre les risques sociaux (redistribution horizontale) et elle permet de réduire les inégalités socio-économiques (redistribution verticale). La politique sociale passe notamment par : – la protection sociale qui répond à une logique d’assistance et/ou d’assurance contre les risques sociaux (maladie, invalidité, chômage, précarité/exclusion, vieillesse, charges de famille, etc.) ; – la fiscalité lorsqu’elle permet de réaliser une redistribution verticale des ressources. La protection sociale s’effectue d’une part par le versement de prestations sociales (prestations pécuniaires), d’autre part par l’offre de services sociaux (prestations non-pécuniaires). Ces dépenses sont financées soit par les cotisations sociales, soit par l’impôt. Une partie de la redistribution verticale des ressources peut s’effectuer par la mise en œuvre de prélèvements obligatoires progressifs. L’efficacité des politiques sociales est aujourd’hui discutée. Le débat s’articule autour de leur financement et de leur capacité à atteindre leurs objectifs. |
Les inégalités socioéconomiques La redistribution horizontale La redistribution verticale La protection sociale La logique d’assurance La logique d’assistance Les impôts et les cotisations sociales La progressivité des prélèvements obligatoires |
Ressources sur les politiques sociales
| Les inégalités socio-économiques | Une vidéo de l’INSEE « Mesurer les inégalités de niveau de vie en France avec le rapport interdécile » Que savez-vous réellement des inégalités de niveau de vie en France ? Savez-vous comment elles sont mesurées ? Comment les interpréter ? L’un des indicateurs phares pour mesurer les inégalités est le rapport interdécile. Derrière ce terme un peu compliqué se cache un calcul assez simple… Le point en image pour comprendre cet indicateur. Une vidéo réalisée par @Datagora, en partenariat avec l’Insee et la Finance pour tous.
|
| Indicateurs d’inégalités | Un dossier INSEE sur l’estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités |
| Inégalités de patrimoine | Une vidéo des JECO « Mesure-t-on bien l’inégalité des patrimoines ? » Conférence organisée le 19 nov 2020 Dans le domaine de l’inégalité, une importance croissante est accordée aux inégalités de patrimoine par rapport aux inégalités de revenu. De fait, une mesure satisfaisante des inégalités économiques devrait prendre simultanément en compte ces deux composantes. La mesure de l’inégalité des patrimoines pose cependant des problèmes par rapport à celle des revenus. Plusieurs sources sont disponibles – enquêtes, successions, capitalisation des revenus de la propriété – qui ne conduisent pas nécessairement à la même appréhension de l’évolution de l’inégalité dans la mesure où elles ne recouvrent pas les mêmes composantes du patrimoine, n’ont pas la même dimension temporelle ou se basent parfois sur des hypothèses fortes d’imputation de la valeur des actifs. Il s’ensuit que la comparaison internationale ou même la comparaison entre deux points du temps est parfois difficile. Cette session a pour objectif de faire le point sur ces questions de mesure et leurs implications quant à l’importance de l’inégalité des patrimoines, son évolution réelle, et l’articulation entre patrimoines et revenus |
| La progressivité des prélèvements obligatoires | Une vidéo Dessine moi l’économie « Comment fonctionnent les impôts ? » Dessine-moi l’éco vous présente sa nouvelle vidéo… un peu différente des vidéos habituelles. Pour profiter de l’animation, il est conseillé d’utiliser le navigateur Google Chrome.
|
| La protection sociale | Une vidéo Dessine moi l’économie sur la protection sociale.
|